Le 14 mai 1948, les volets claquaient encore au vent de l’avenue Rothschild, et dans un musée qui n’avait de musée que le nom, on fit résonner des mots qu’on rêvait depuis Babylone. À saisir des heures précises, un homme aux cheveux drus et au regard de granit s’élève derrière un pupitre de fortune, lu d’une voix sèche, presque cassante, un texte qui allait changer le cours d’un exil. Et pourtant, au cœur de l’embrasement — entre les canons de Latroun et les ultimatums jordaniens – il lut la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël. Mais ce qu’elle disait, et surtout ce qu’elle ne disait pas, voilà peut-être le vrai nœud de l’histoire. On la croit limpide. Elle ne l’est pas. On y lit « État juif », comme on lit un titre sur du marbre. Mais qui est ce « juif » dont on parle ? Est-ce un adjectif ? Un héritage ? Une promesse biblique ? Un code ethnique ? Rien dans le texte ne tranche. Ni loi, ni halakha. Ni prophétie, ni règle. Le mot Dieu n’y figure pas — ou à peine, travesti sous le masque pudique du « Rocher d’Israël », formule volontairement équivoque pour ne pas heurter ni les croyants, ni ceux qui croient au contraire. Et pourtant, tout y affleure : l’angoisse, la foi, la mémoire, les cendres. Il faut dire que cela faisait deux mille ans qu’on attendait. Pas seulement un retour, mais le retour.

Pas un billet d’aliyah, non : un basculement du monde. À chaque Pessah, les générations disaient « L’an prochain à Jérusalem » comme on ressemble à une adresse où personne n’a jamais habité, mais qu’on garde sur soi comme un talisman. Et dans chaque mariage, sous la houppa, retenait ce verset ancien : « Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche ». Cela ne relève pas de la nostalgie. C’est une grammaire. C’est une sorte d’obsession structurée, presque mathématique, où chaque événement politique doit se mesurer à la hauteur d’une attente sacrée. Mais ce 14 mai, dans le feu du réel, ce qu’on créa fut une chose incertaine. Ni royaume messianique, ni forteresse halakhique. Un État moderne, bureaucratique, façonné par des anciens d’Europe centrale, formé au marxisme plus qu’à Maïmonide. Un État sans Sanhédrin, sans prophètes, mais pas sans ambition. Un État où l’on parlait hébreu, oui, mais un hébreu régénéré, passé par Eliezer Ben Yehuda plus que par Ezéchiel. Le fait est là : Israël naquit comme une créature de l’histoire, pas de la tradition. Et pourtant, l’héritage était là, enfoui. Car que serait vénus, dans cette poussière de sabra et de béton brut, des juifs de Djerba, de Bagdad, de Vilna, sinon l’écho d’une promesse plus haute que la citoyenneté ?
Ils ne vinrent pas pour des infrastructures. Ils vinrent parce qu’un appel sourd les tirait hors du monde. Parce qu’en eux, quelque chose se souvenait d’un verset, d’un nom, d’une arche, d’un pacte. L’État, lui, n’en fit pas toujours cas. Il les intègre, mal parfois. Mais le sol était là, et le souffle aussi. Il tenterait de dire que les fondateurs ont trahi. Mais ce serait trop simple. Ils ont décidé ce qu’ils pouvaient. Dans le fracas d’une guerre naissante, entre l’idéalisme des poètes et la pression des Nations Unies, ils ont tiré un texte d’équilibristes. On y parle de justice, de paix, d’égalité. On y invite les Arabes à bâtir ensemble, dans un même souffle, ce qui déjà s’effondrait sous les obus. Sur j’espère. En proclamation. On ne définit pas. Et peut-être est-ce cela, le paradoxe fondateur : avoir nommé « juif » ce que l’on refusait de borner. Avoir fondé un État en se gardant bien d’en dire la nature. Résultat ? Soixante-quinze ans plus tard, on en débat encore.Est-ce une patrie pour les Juifs ? Ou un État juif dans son essence ? Est-on chez soi à Safed quand est-on juif de New York ? Ou seulement si l’on parle l’hébreu de la rue ? Questions ouvertes. Questions vivantes. Ce qui est certain, c’est que le 14 mai 1948 ne fut pas la fin de l’histoire juive. Ce fut une césure, un geste. Quelqu’un a choisi comme une tentative d’incarner, dans le langage du XXe siècle, une attente vieille de l’âge du bronze. Et que cette tentative soit imparfaite n’annule pas sa beauté. Elle la rend humaine.
Loin des récits figés, ce moment fondateur fut un geste d’improvisation lucide. L’une des principales querelles, et non des moindres, concernait l’évocation de Dieu : fallait-il nommer explicitement l’Éternel dans ce texte séculier mais chargé de sens biblique ? Le compromis fut d’une subtilité toute talmudique : “Tsur Israël” – le Rocher d’Israël – une formule capable de parler à la fois aux croyants et aux laïcs, aux mystiques et aux stratèges. Le choix de l’heure, lui aussi, est tout sauf anodin. Il fallut proclamer l’État avant le début du Shabbat, sans pour autant reculer devant l’urgence politique. Ce fut donc à 16 heures précises, un vendredi, que les portes du musée de Tel Aviv s’ouvrirent à l’Histoire. Ce détail, purement logistique en apparence, fut au cœur d’intenses discussions halakhiques. Ben Gourion, pourtant résolument laïc, tint à ce que la cérémonie s’achève avant l’entrée du Shabbat. Ainsi, le jeune État naquit dans un entre-deux : entre la lumière mourante du vendredi et le repos sacré du septième jour, entre la temporalité politique et l’éternité liturgique. Mais l’image la plus saisissante de cette journée reste peut-être celle, presque burlesque, des signataires signant… sur une feuille blanche. Faute de disposer d’un document officiel finalisé à temps, certains furent priés d’apposer leur signature sur une simple page, sans texte. Ce geste, en apparence dérisoire, témoigne pourtant de l’urgence et de l’irréversibilité du moment. On signait non un texte, mais une promesse. Certains signèrent à distance, d’autres par procuration : c’est que l’Histoire, parfois, ne prévient pas.

Quant aux mots choisis, ils portent encore aujourd’hui leur part de mystère et d’ambiguïté. “État d’Israël”, lit-on dans le texte. Le terme “État juif”, pourtant au cœur de la résolution onusienne de novembre 1947, brille par sa discrétion. Ce silence relatif n’est pas un oubli, mais une stratégie : ménager les minorités, ne pas braquer la communauté internationale, et surtout, ne pas enfermer d’emblée l’État dans une définition religieuse ou ethnique univoque. Cette tension lexicale habite encore aujourd’hui les débats les plus vifs sur la nature même d’Israël, oscillant entre l’idéal démocratique et la vocation particulière d’un foyer juif. Enfin, chose étonnante, ce texte s’adresse d’abord… aux absents. “Nous lançons un appel au peuple juif de par le monde” : c’est à la diaspora, éparpillée, meurtrie, que s’adresse la jeune république, bien plus qu’aux puissances ou aux voisins. Par cette adresse, l’État d’Israël ne se contente pas d’acter son existence politique ; il revendique une filiation mystique. Il se présente comme l’aboutissement d’un exil, la réponse à des siècles de silence et de prières. Le lien ainsi tracé ne relève pas seulement de l’histoire, mais du destin. Car en ce jour de mai, ce n’est pas seulement un pays qui naît, c’est une mémoire qui se fait chair, un espoir qui prend corps.
Eden Levi Campana
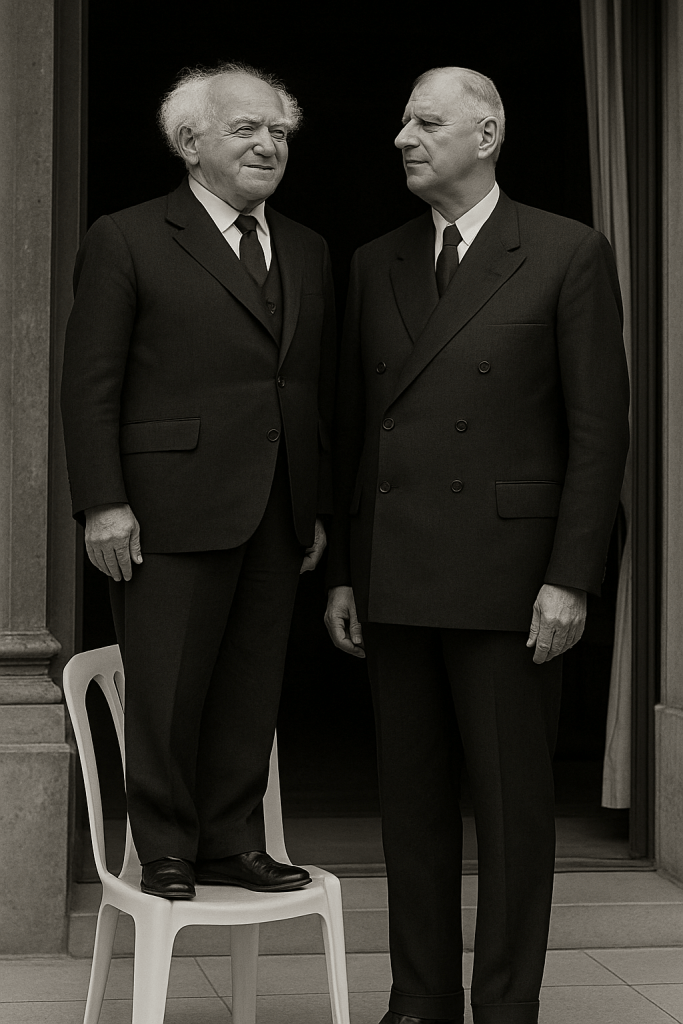
En savoir plus sur EDEN LEVI CAMPANA
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.